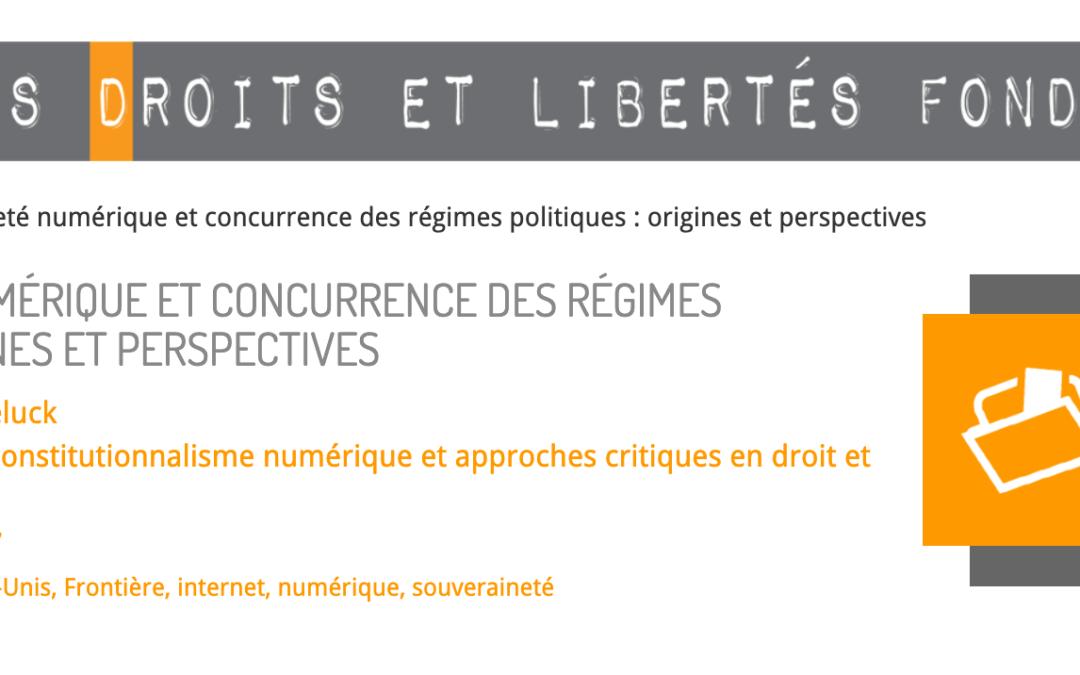Publication dans le cadre du dossier « Constitutionnalisme numérique et approches critiques en droit et technologie » de la Revue des droits et libertés fondamentaux, coordonné par Manon Altwegg-Boussac et Afroditi Marketou.
Benjamin Loveluck, « Souveraineté numérique et concurrence des régimes politiques : origines et perspectives », RDLF 2025 chron. n°47
Cette contribution propose un éclairage sur l’émergence de la notion de souveraineté numérique, qui s’est imposée dans les débats publics sur la gouvernance numérique malgré un flou conceptuel certain. En effet, la souveraineté numérique englobe plusieurs dimensions, allant du contrôle des données et des infrastructures, à la régulation des marchés numériques et des contenus en ligne, et la défense des citoyens et des consommateurs – ces différents objectifs pouvant également présenter un caractère contradictoire. Apparue initialement dans les cercles relativement restreints des débats sur la gouvernance d’internet et en tant que revendication émanant de pays contestant la mondialisation libérale (en particulier la Chine et la Russie), la souveraineté numérique est désormais mobilisée par différents acteurs politiques, dans un contexte de renforcement des frontières nationales et de protectionnisme croissant, renvoyant aux luttes géopolitiques qui traversent l’espace international.
Or la notion de souveraineté ne va pas de soi dans le contexte d’internet, bien au contraire. En effet, elle désigne en particulier l’exercice d’une autorité légitime sur un territoire donné, tandis que pendant longtemps, le réseau a été présenté comme intrinsèquement déterritorialisé – un espace de communication global et de « libre circulation de l’information » qui s’accorderait mal avec les juridictions nationales. Dans sa plus simple expression, la souveraineté numérique renvoie à la capacité d’interrompre les flux d’information, ou du moins de les moduler – or si cette prérogative appartient en théorie aux états (quelle que soit leur légitimité), en pratique elle s’exerce à travers les intermédiaires techniques et de services (opérateurs, fournisseurs d’accès, plateformes etc.) par lesquels transitent ces flux, qui ont également une portée transnationale. Différentes autorités, de jure et de facto, se sont ainsi affirmées et parfois concurrencées au gré des controverses et conflits qui ont jalonné l’histoire récente du numérique, conduisant parfois à des compromis mais aussi à des tensions persistantes.